Fil d'ariane
Un plaidoyer pour la lucidité
Depuis dix ans, les gouvernements changent, les ministres se succèdent, les priorités se déplacent, … mais la santé, elle, continue de payer !
Alors que le gouvernement a ouvert le 20 octobre 2025 les discussions autour des budgets 2026, la Fédération Diversité et Proximité Mutualiste souhaite rappeler que derrière chaque arbitrage comptable se joue l’avenir d’un système de santé déjà fragilisé
La FDPM souhaite, à travers ces mots, s’adresser à ces instances éphémères qui, une fois encore, décideront du sort de notre système de santé sans jamais le considérer dans sa globalité.
Chaque automne, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) promet de « préserver notre système de santé », de « renforcer la prévention » ou « d’améliorer l’accès aux soins ». Et chaque année, la réalité est la même : moins de solidarité nationale, plus de charges transférées vers les mutuelles sans concertation, un coût de la santé plus cher pour les citoyens.
Le PLFSS 2026 ne déroge pas à la règle. Derrière les mots rassurants : « responsabilisation », « innovation », « efficience », … se cache uniquement une logique budgétaire à courte vue :
Une taxation de 1 milliard d’euros sur les complémentaires santé, présentée comme un effort « de solidarité », qui n’a d’exceptionnelle que le nom et qui amputera les cotisations des adhérents.
Une hausse des franchises et participations forfaitaires, et surtout un doublement de leurs plafonds, qui pénaliseront d’abord les malades chroniques et les plus modestes.
Une progression des dépenses d’assurance maladie limitée à 1,6 %, manifestant un déni du législateur en matière de vieillissement de la population et de santé publique.
Un transfert implicite du financement de la santé vers les mutuelles, alors même que le pouvoir d’achat des ménages est déjà sous tension.
Pendant ce temps, le gouvernement affiche sa volonté de « renforcer la prévention » : un nouveau parcours dédié aux maladies chroniques, 5 000 «Maisons France Santé » d’ici 2027, des campagnes de communication sur la santé publique… Mais dans les faits, à titre d’exemple, certains vaccins (notamment celui contre la bronchiolite, qui fait actuellement l’objet d’une importante campagne de prévention en faveur de la santé des nourrissons) ne sont encore remboursés qu’à hauteur de 30 %, la prévention bucco-dentaire reste sous-dotée, et la santé mentale des jeunes est la grande oubliée du budget.
Ce grand écart entre les annonces et la réalité n’est plus tenable. Les mutuelles, qui ne sont ni des banques, ni des sociétés d’assurances, mais des acteurs solidaires à but non lucratif, sont une fois encore traitées comme un levier fiscal, alors qu’elles représentent la dernière barrière avant le renoncement aux soins.
Nous ne défendons pas un modèle économique : nous défendons nos adhérents.
Ces millions de Français voient leurs cotisations augmenter, non par choix, mais à cause du transfert de charges de l’État, qui fragilise la sécurité sociale par des décisions purement comptables plutôt que de s’attaquer aux véritables problèmes de fond. Ces familles qui paient deux fois : par l’impôt, et par la complémentaire. Ces retraités, ces salariés, ces étudiants, qui attendent des actes, pas des slogans.
Oui, la santé doit s’adapter, innover, se moderniser. Mais pas au prix d’un désengagement déguisé, ni sur le dos des solidarités qui fondent notre modèle social.
La santé n’est pas un budget d’ajustement. C’est un pacte de confiance. Et ce pacte, aujourd’hui, est rompu.
Dix ans de décisions contre les mutuelles et contre les adhérents
Dix ans de décisions contre les mutuelles… et contre les adhérents
Depuis une décennie, la politique de santé publique suit une logique de désengagement progressif de la solidarité nationale. Chaque réforme, chaque loi de financement, chaque «ajustement » budgétaire a déplacé un peu plus la charge des soins de la Sécurité sociale vers les organismes complémentaires.
Mais derrière ces organismes, il ne faut jamais l’oublier, il y a les adhérents : des citoyens, des familles, des retraités, des étudiants, qui paient, eux, la facture.
2015–2017 : la bascule silencieuse
Sous couvert de «responsabilisation », la Sécurité sociale entame une série de déremboursements ciblés (médicaments, soins optiques, certains vaccins, dispositifs médicaux).
Les mutuelles sont contraintes de compenser, entraînant mécaniquement une hausse des cotisations. Dans le même temps, la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise (2016) modifie l’équilibre du système : elle a instauré une ségrégation entre les salariés et les retraités et précaires, creusant ainsi les inégalités d'accès aux soins. Elle a aussi provoqué la disparition de nombreuses petites mutuelles, pourtant actrices de la solidarité sur leurs territoires.
Le contrat responsable est revu et deviendra le réceptacle de transferts de charges à venir.
2018–2019 : le «100 % santé » et ses angles morts
Présenté comme une avancée sociale, le dispositif «100 % santé » (optique, dentaire, audiologie) a effectivement permis à certains assurés d’accéder à des soins essentiels.
Mais il a aussi entraîné un effet mécanique sur les cotisations, puisque les complémentaires ont absorbé une large part du coût du dispositif.
Pendant que l’État se désengageait, les mutuelles ont tenu la promesse du «reste à charge zéro », mais sans compensation réelle de la part de la puissance publique.
2020–2022 : crise sanitaire, crise de confiance
Pendant la pandémie de COVID-19, les mutuelles ont assumé leur rôle sans faillir : maintien des garanties, soutien financier aux établissements, dispositifs solidaires pour les adhérents et les entreprises en difficulté. Mais au sortir de la crise, alors que le surcoût du 100% Santé pesait déjà sur les comptes des mutuelles, plutôt qu’une reconnaissance, elles ont subi une première contribution exceptionnelle sur 2 exercices.
Le message était clair : la solidarité mutualiste devait financer les déficits de l’État.
2023–2025 : l’inflation, la prévention à géométrie variable
Alors que les dépenses de santé augmentent sous l’effet de l’inflation, le gouvernement multiplie les campagnes de prévention (tabac, nutrition, santé mentale, …) sans cohérence avec les remboursements effectifs. Les consultations psychologiques plafonnées et les soins dentaires font toujours l’objet d’arbitrages à court terme. Dans le même temps, les PLFSS successifs ont continué à ponctionner les complémentaires, tout en limitant les dépenses publiques d’assurance maladie à des niveaux historiquement bas.
2026 : un nouvel épisode, la même logique
Le PLFSS 2026 achève de le démontrer : la santé est devenue un champ de redressement budgétaire.
Comme évoqué précédemment :
Une taxation exceptionnelle de 1 milliard d’euros s’ajoute aux contributions existantes.
Les franchises et participations forfaitaires sont doublées, renforçant les inégalités d’accès aux soins.
Le taux de progression des dépenses d’assurance maladie est plafonné à 1,6 %, soit bien en dessous de la croissance des besoins réels.
Résultat : la facture sera, une fois de plus, reportée sur les mutuelles, donc sur les cotisants.
Il nous est annoncé dans le PLFSS 2026 la révision du périmètre des contrats responsables. Cela semble logique puisqu’il a concentré bien trop de coûts (dont notamment le marché très lucratif de l’optique et de l’audioprothèse : la 2ème paire voire la 3ème à 1€, les seconds appareils auditifs à 1€ et pourquoi pas bientôt les 3èmes ? Sans oublier les campagnes de publicité abusives qui inondent les médias). Cependant, sans concertation depuis des années, comment sera menée cette réforme et dans quel timing ?
Un constat simple : ce sont les adhérents qui trinquent !
Car derrière chaque «mesure technique », chaque ligne budgétaire, il y a une réalité humaine : des familles qui voient leurs cotisations augmenter, des retraités qui renoncent à une mutuelle devenue trop chère, des jeunes qui font le choix de ne pas se couvrir et des territoires où l’accès aux soins se dégrade, … Le système mutualiste, pilier historique de la solidarité française, est peu à peu asphyxié par une logique comptable. Et c’est toute la promesse d’un modèle fondé sur la solidarité, l’équité et la non-lucrativité qui s’en trouve menacée.
Un double discours permanent : la prévention affichée, le désengagement réel
La prévention est devenue le mot magique de toutes les politiques de santé. Chaque plan, chaque loi, chaque discours ministériel en fait un pilier. Mais à force d’être proclamée, la prévention s’est vidée de sa substance, remplacée par une communication institutionnelle et quelques mesures symboliques.
Des parcours «préventifs » sans financement réel
Le PLFSS 2026 annonce la création d’un «parcours de prévention pour les maladies chroniques », censé concerner un quart de la population d’ici 2035. Sur le papier, l’intention est louable. Et si cela voit le jour, nous saurons l’apprécier. Mais derrière l’annonce, aucune précision sur les moyens, les professionnels impliqués, ni la prise en charge réelle des actes. Le risque est clair : un parcours théorique, sans moyens concrets, qui reposera encore sur la bonne volonté et les ressources des acteurs de terrain dont les mutuelles.
Des campagnes de prévention… mais des soins sous-remboursés
Chaque année, des millions d’euros sont investis dans des campagnes de prévention : alimentation, dépistage, activité physique, santé mentale.
Pourtant, les actes qui traduisent cette prévention dans la vie quotidienne restent mal remboursés :
Certains vaccins essentiels faiblement pris en charge par la sécurité sociale.
Les bilans de santé en médecine de ville restent rares et non valorisés.
Les consultations psychologiques demeurent plafonnées à des montants dérisoires.
Les soins dentaires de prévention sont marginalement soutenus par la Sécurité sociale.
Résultat : la prévention se limite à des slogans, alors que la réalité du reste à charge dissuade les plus fragiles d’agir en amont.
La santé mentale, grande absente des priorités budgétaires
Les troubles psychiques touchent un Français sur cinq, particulièrement les jeunes. Pourtant, les dispositifs de soutien psychologique sont insuffisants, sous-financés, et soumis à des plafonds incompatibles avec les besoins réels.
Le PLFSS 2026 parle d’«innovation » et de «maillage territorial », mais aucune mesure structurelle n’est annoncée pour renforcer durablement la santé mentale publique. Les mutuelles, elles, ont pris le relais depuis des années : remboursement de séances de psychologues, soutien aux étudiants, dispositifs d’accompagnement, financement de programmes de prévention en entreprise. Mais là encore, ces efforts reposent sur les cotisations des adhérents, pas sur un investissement collectif.
La prévention sans solidarité : une impasse
Un système de santé ne peut pas reposer sur des incitations individuelles et des taxes collectives. Doubler les franchises médicales ou limiter la durée des arrêts maladie au nom de la «responsabilisation » revient à culpabiliser les malades plutôt qu’à renforcer la santé publique.
La prévention n’est pas une sanction, c’est un investissement. Et cet investissement doit être partagé entre l’État, les professionnels de santé, les collectivités… et non transféré une fois de plus aux Français par le biais des mutuelles.
Vers une vraie politique de prévention
Ce que les Français attendent, ce ne sont pas de nouveaux parcours ou des slogans, mais :
Des soins de prévention réellement pris en charge, sans reste à charge dissuasif;
Une santé mentale reconnue comme priorité nationale;
Des territoires couverts équitablement, avec des médecins et des structures accessibles ;
Des partenariats renforcés entre l’État, les mutuelles et les professionnels pour agir sur le terrain, pas seulement dans les budgets.
Les mutuelles sont prêtes à jouer leur rôle dans cette refondation de la prévention. Mais elles ne peuvent pas être la béquille budgétaire d’un système qui annonce la prévention tout en coupant les moyens. Prévenir, c’est anticiper. Taxer les organismes solidaires et réduire la couverture des soins, c’est exactement l’inverse.
Les mutuelles ne sont pas des sociétés d’assurances
Depuis plusieurs années, les mutuelles sont mises sur le même plan que les acteurs financiers, soumises aux mêmes contraintes fiscales et aux mêmes obligations réglementaires.
À écouter certains discours, elles ne seraient qu’un rouage du «marché de la complémentaire santé ». C’est une erreur fondamentale. Et surtout, une erreur de vision.
Une confusion entretenue par les politiques publiques
Les taxes, les obligations administratives, les plafonnements sont appliqués indistinctement aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux sociétés d’assurance, ou encore aux banques. Cette uniformisation du traitement, justifiée au nom de «l’équité », revient en réalité à nier la spécificité du modèle mutualiste :
Les mutuelles n’ont pas d’actionnaires à rémunérer ;
Elles ne distribuent pas de profits, mais reversent leurs excédents aux adhérents ou les réinvestissent dans leur protection ;
Elles sont gérées démocratiquement, chaque adhérent y disposant d’une voix, quel que soit le montant de sa cotisation ;
Elles incarnent une solidarité intergénérationnelle et territoriale que nul acteur privé ne reproduit.
Pourtant, le PLFSS 2026 les traite comme des entités à contribution variable, capables d’absorber une nouvelle taxation exceptionnelle d’un milliard d’euros, sans jamais mesurer l’impact réel sur les cotisations des adhérents.
Cette assimilation aux logiques assurantielles est non seulement injuste, mais contre-productive : elle affaiblit les organismes qui, justement, permettent à la solidarité de tenir.
Un modèle au service des citoyens, pas des marchés
Les mutuelles ont été créées pour protéger les citoyens face aux risques de la vie, et non pour générer des marges financières.
Elles sont nées d’un principe simple : la santé n’est pas une marchandise, mais un bien commun.
Elles représentent aujourd’hui près de 30 millions d’adhérents et garantissent un accès aux soins dans des milliers de territoires. Chaque euro prélevé sert à améliorer les remboursements, soutenir les structures de soins mutualistes, ou renforcer la prévention locale.
Et pourtant, ce modèle, unique en Europe par son ampleur, est fragilisé par une fiscalité cumulative et une absence de reconnaissance institutionnelle.
Une reconnaissance urgente de la différence mutualiste
Les pouvoirs publics ne peuvent pas, d’un côté, appeler à «préserver la solidarité » et, de l’autre, affaiblir les organismes qui la font vivre. Traiter les mutuelles comme des sociétés d’assurance à but lucratif revient à effacer la frontière entre solidarité et rentabilité, entre bien commun et produit financier.
Si la santé devient un marché, alors c’est la cohésion sociale qui devient un coût.
Si la solidarité devient taxable, alors c’est la société tout entière qui devient inéquitable.
Une demande claire : différencier pour protéger
Nous ne réclamons pas de privilèges. Nous demandons simplement que la spécificité mutualiste soit reconnue et protégée dans les décisions publiques.
Parce qu’elle n’est pas une niche, ni une exception. C’est un pilier du modèle social français.
Et sans ce pilier, ce sont des millions de citoyens qui tomberont entre les mailles du filet de la protection sociale.
Défendre les adhérents, pas un modèle économique
Depuis dix ans, on parle des mutuelles comme de structures «à réguler », «à responsabiliser » ou «à taxer davantage ». Mais on oublie que les mutuelles n’existent que parce qu’elles défendent des personnes : des millions d’adhérents, de tous âges, de tous métiers, dans tous les territoires.
Chaque mesure prise contre les mutuelles se traduit, in fine, par une facture supplémentaire pour les citoyens.
Quand la Sécurité sociale se désengage, les mutuelles compensent.
Quand l’État prélève une taxe exceptionnelle, ce sont les adhérents qui paient.
Quand on modifie le périmètre des contrats responsables, ce sont les garanties qui en pâtissent.
Et quand on limite la progression des dépenses d’assurance maladie, ce sont les Français qui limitent leurs soins.
Les adhérents, première variable d’ajustement du système
Ces dernières années, le nombre de Français renonçant à certains soins n’a cessé d’augmenter.
Non pas par choix, mais par contrainte. Les familles les plus modestes réduisent leurs consultations, les jeunes repoussent les soins préventifs, les retraités renoncent à des couvertures devenues trop coûteuses.
La taxation accrue des complémentaires n’est pas neutre : elle pèse directement sur le pouvoir d’achat santé des ménages.
D’ailleurs, l’idée même de taxation de la santé est un non-sens.
Et c’est précisément cette dérive que la FDPM dénonce : une politique de santé qui transforme la solidarité en charge et la prévention en luxe.
Des inégalités territoriales et sociales qui s’aggravent
Le gouvernement promet de créer 5 000 «Maisons France Santé » d’ici 2027.
Augmenter l’offre de soins est une mesure bienvenue, nous le concédons bien volontiers. Mais il faut au préalable travailler sur la pénurie de médecins et de spécialistes, ainsi que sur l’inégalité d’accès aux soins.
Dans de nombreux territoires ruraux ou ultramarins, ce sont les structures mutualistes (centres de santé, établissements médico-sociaux, services de soins infirmiers, …) qui maintiennent une offre de proximité. Elles le font sans logique de profit, avec pour seul objectif la continuité des soins.
Les fragiliser, c’est affaiblir la présence sanitaire dans les zones déjà délaissées.
Le pouvoir d’achat santé : la ligne rouge
Chaque hausse de taxe, chaque déremboursement, chaque réforme de périmètre a un impact concret : la cotisation mensuelle d’un adhérent.
Ce qui semble être une mesure technique ou budgétaire devient, sur le terrain, un choix entre se soigner ou payer ses factures. Et dans un contexte d’inflation persistante, l’accès à la santé ne peut pas devenir un marqueur social. C’est pourquoi notre Fédération plaide pour un principe simple :
Aucune réforme de financement ne doit aggraver le reste à charge des Français ni menacer la continuité de leur couverture santé.
Pour une refondation du pacte social santé
Il est temps de repenser la répartition des responsabilités :
à la Sécurité sociale, le retour à la garantie d’une solidarité nationale forte et stable ;
aux mutuelles, le rôle d’acteur complémentaire agissant en concertation avec l’État pour repenser un système de santé efficace, financièrement maîtrisé et répondant aux enjeux d’aujourd’hui et de demain;
aux citoyens, la confiance dans un système lisible et équitable.
Ce n’est pas un combat d’intérêts, c’est un combat de sens : celui d’un modèle de santé qui protège avant de punir, qui soigne avant de compter, et qui place l’humain avant le budget.
Appel à la responsabilité collective
La santé n’appartient à aucun gouvernement, à aucun ministre, à aucune majorité.
Elle appartient à celles et ceux qui la vivent, la pratiquent, la soutiennent et la financent : les citoyens, les professionnels, les collectivités, et les mutuelles.
Depuis dix ans, les réformes se succèdent, souvent sincères dans leurs intentions, mais désordonnées dans leurs effets.
À force de corriger les déficits sans corriger les déséquilibres, le système s’épuise.
À force de parler de «prévention », on oublie d’en financer les actes.
À force de taxer les acteurs solidaires, on érode le lien de confiance qui fonde la solidarité.
Le PLFSS 2026 en est le dernier exemple : il promet la transformation du système de santé, mais il en accentue la fragilité structurelle. Les mutuelles, une fois encore, sont sollicitées comme un levier financier, jamais comme un partenaire de solution. Nous n’attendons pas des faveurs. Nous attendons une vision.
Une politique de santé qui reconnaisse que la solidarité ne se décrète pas, elle s’organise ; que la prévention ne se proclame pas, elle se finance ; et que la confiance ne se réclame pas, elle se construit.
Nous appelons le gouvernement, les parlementaires et l’ensemble des décideurs publics à rouvrir un vrai dialogue sur la place des mutuelles dans le système de santé. Un dialogue sans caricature, sans dogme, sans arrière-pensée budgétaire, fondé sur une conviction commune : La santé n’est pas un coût, c’est un investissement collectif dans la dignité humaine.
La FDPM est prête à s’inscrire dans une nouvelle ère (peut-être ambitieuse, voire utopique) où les décisions du ministère de la Santé pourront être débattues et partagées en amont. Il paraît essentiel, dans ce contexte, d’associer l’ensemble des acteurs de santé aux réflexions menées. Nous réaffirmons donc notre entière ouverture au dialogue et espérons que les engagements pris en ce sens seront tenus.
Les mutuelles continueront d’assumer leur rôle : protéger, prévenir, accompagner.
Mais elles ne peuvent plus être le tiroir-caisse d’un désengagement national, ni le prétexte d’une politique de santé à géométrie comptable.
Ce plaidoyer n’est pas un cri d’alarme, c’est un appel à la lucidité.
Car si la santé devient une variable budgétaire, alors c’est la société tout entière qui devient malade.
Et il n’existe aucune mutuelle pour rembourser cette fracture-là.


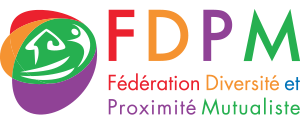

.png)